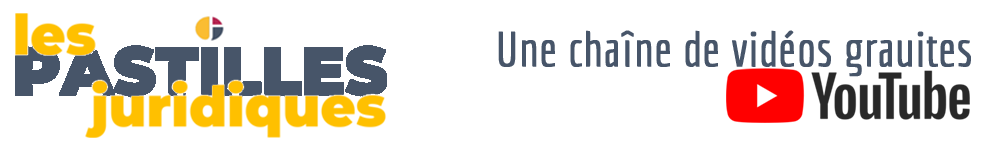Civil : Les personnes
Civil : Les personnes
Identification des personnes physiques
L'identification d'une personne physique est organisée autour de la notion "d'état des personnes" : critères physiques, juridiques ou sociaux (âge, sexe, filiation, capacité, situation matrimoniale) dont les individus ne disposent pas (seuls les juges peuvent les modifier), mais aussi autour de notion accessoires (les "attributs de l'etat") comme le nom, le prénom ou la nationalité.
L'état
L'état d'une personne rassemble certains critères d'identification personnels où concernant sa situation juridique.
Les personnes ne peuvent en disposer librement (principe de l'indisponibilité de l'état des personnes).
Les critères sont :
L'état civil
Système officiel de constatation de l'état des personnes, de manière à pouvoir en aménager la preuve. On y constate la naissance, le mariage et le décès (un registre par événement).
Organisation de l'état civil
Le maire est officier d'état civil (ou ses agents par délégation). Il est chargé de tenir les trois registres en double
exemplaire, dont un est conservé au T.G.I.
En cas d'erreur ou d'omission, une rectification de l'état civil peut être demandée au
Procureur de la République. Au contraire si l'état civil est inexact, incomplet ou en cas de changement d'état civil, seul le juge peut
opérer la modification.
La consultation des registres de moins de 100 ans est interdite. Cependant des copies ou des extraits peuvent être
obtenus, mais la simple photocopie du livret de famille est désormais suffisante pour établir son état civil.
Le nom
Le nom global d'une personne inclue son nom de famille, son présom et éventuellement son pseudonyme, surnom ou titre nobiliaire.
Le nom de famille
Aujourd'hui encore : le nom du père est par tradition attribué à l'enfant d'un couple (le seul nom de la mère au cas
où le père ne l'a pas reconnu). Le nom de la mère peut à titre d'usage être placé en seconde position, sans que l'enfant
ne puisse le transmettre à ses propres enfants.
Cependant, la loi du 4 mars 2002 a modifié profondément le régime du nom
patronymique qui prend le nom de "nom de famille" dans la mesure où la référence au nom du père n'est plus primordiale.
C'est cette loi qui est présentée ici.
Nom et filiation :
L'acquisition du nom de famille se fait par référence à aux parents.
Un enfant reconnu par ses deux parents
(conjointement par déclaration préalable ou le jour de la déclaration ou simultanément par la suite), prend indifféremment
le nom de sa mère, le nom de son père ou leur double nom (dans l'ordre choisi par les parents). Le chois effectué pour le premier enfant vaut
pour les suivants afin d'assurer une cohérence familiale.
Afin d'éviter la succession infinie de nom, un parent qui porte un nom multiple ne peut
transmettre que le premier de celui-ci.
A défaut, l'officier d'état civil indique le nom du père (règle antérieure).
Par contre, l'enfant qui n'a qu'un seul parent ou celui que les parents n'ont pas reconnu dans le même temps, porte le nom de famille de celui qui l'a reconnu en
premier.
Dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur de cette loi (sept. 2003), les parents dont les enfants ne seront pas âgés
de plus de treize ans, peuvent opter pour le nom multiple. Le nom de l'autre parent sera mis en deuxième position. Ce choix vaudra pour toute la fraterie.
Changement de nom :
Une personne peut être amenée à changer de nom, ce qui est admis dans différentes hypothèses :
Le changement de nom est aussi possible, en dehors d'un changement d'état, lorsque :
La demande doit être adressée au Garde des Sceaux. Un décrêt officialisera le changement de nom de famille, à moijns qu'un tiers ne s'y oppose dans les deux mois auprès du conseil d'Etat.
Nom et mariage :
A titre d'usage, une femme mariée peut, sans perdre son nom de famille, prendre celui de son époux.
En cas de divorce, elle en
perd l'usage, sauf accord de son ex-mari, autorisation du juge (à condition de justifier d'un intérêt particulier à le faire) ou en cas de
divorce pour rupture de la vie commune à l'initiative du mari.
Les accessoires du nom
Prénom :
Chaque personne doit avoir au moins un prénom. Il est librement choisi par les parents.
Cependdant, si l'officier d'Etat civil estime que
celui-ci est ridicule ou de nature à nuire à l'enfant, il peut en avertir le Procureur de la République qui pourra, le cas échéant,
saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera la question.
Le changement de prénom est en principe interdit, sauf en cas :
Surnom :
Prénom d'usage qui n'a aucune valeur juridique.
Pseudonyme :
Il n'a pas vraiment de valeur juridique, en ce sens où il ne peut se substituer aux nom et prénom dans les actes officiels.
En revanche, il est protégé contre d'éventuelles usurpations : il peut être fait interdiction à une personne d'utiliser un
même pseudonyme dans le but de bénéficier de sa notoriété.
Titres de noblesse :
Si les règles d'acquisition des titres de noblesse sont toujours en vigueur, ceux-ci n'ouvrent plus droit à
aucun privilège quelconque, mais sont toutes fois protégés contre d'éventuelles usurpations.
Le domicile
Le domicile permet de fixer les individus à un endroit déterminer afin de pouvoir leur donner certains droits ou obligations. C'est le
domicile qui guide :
Le choix du domicile est libre à condition que la personne réside vraiment à
l'endroit déterminé et qu'il y concentre ses intérêts familiaux, professionnels ou pécuniaires.
Les modes de vie actuels
induisent parfois une pluralité de lieux de résidence : le juge peut alors tel ou tel critère pour déterminer le lieu du domicile. Il faut
remarquer par ailleurs qu'un domicile "apparent" peut valablement être admis, malgré le principe voulant qu'une personne n'ait qu'un seul
domicile.
Il existe des exceptions à ces règles :
La nationalité
Il existe différents modes d'acquisition de la nationalité française :
Dernière mise à jour : 04-06-2015
 Question(s) de droit
Question(s) de droit